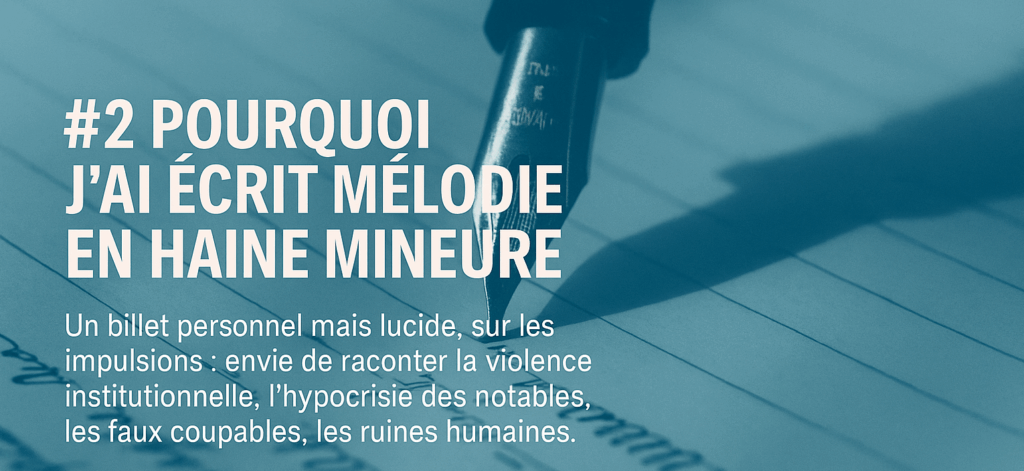Préambule
Dans ce deuxième échange, c’est Tom Roussel — personnage central du roman — qui mène l’interview.
Il me confronte cette fois à l’un des passages les plus dérangeants de Mélodie en haine mineure : le meurtre de Caroline Darme, abattue de sang-froid dans une ruelle, sans raison apparente.
Une véritable miraculée… mais peut-être pas si innocente que ça.
Un meurtre sans mobile… apparent
Entretien avec Alexandre HOS – par Tom Roussel
TOM ROUSSEL : Alexandre, on va parler de Caroline Darme. Vingt-huit ans. Abattue en pleine rue, de nuit. Pas de mobile apparent. Tu fais du gendarme Blanpart, mon ami, le témoin indirect de cette exécution absurde. Pourquoi cette scène ? Pourquoi elle ?
ALEXANDRE HOS
Parce que tout ne doit pas avoir de sens. Justement.
Ce meurtre-là — dans le roman comme dans l’Affaire du Tueur fou — démontre toute la violence et l’absurdité de certains crimes. Avec celui-ci, le Tueur fou ouvre le bal. Un bal macabre.
Dans le roman, cette scène brise quelque chose dans la narration. Elle fait choc. Elle pose des questions. Elle rend l’enquête plus trouble, plus instable. On croit comprendre, et puis non. C’est une exécution froide, sèche, injustifiable — et c’est exactement ça qui m’intéressait. Parce que peut-être, derrière cette apparente gratuité, se cachent les vraies raisons. Les raisons que le tueur lui-même n’assume pas ou ne comprend plus.
Caroline Darme, ce n’est pas une victime “utile”. C’est une victime qui dérange. Qui déroute. Qui fait surgir cette question : jusqu’où va la logique du tueur ? Où s’arrêtera-t-il ? Est-ce qu’il y a encore une logique, ou seulement une mécanique aveugle, lancée, qui broie tout sur son passage ?
Et puis, il y a aussi une raison plus instinctive : à ce moment du roman, je voulais qu’on sente que plus personne n’est à l’abri. Ni les coupables. Ni les innocents. Ni même ceux qu’on croyait intouchables.
C’est d’ailleurs ce qui s’est passé dans la réalité.
Pour le maréchal des logis Blanpart, eh bien je voulais qu’il soit le lien entre le présent et le passé. Qui plus c’est ton meilleur ami, non ?
TOM ROUSSEL : Mais c’est un coup bas, ça. Elle était innocente. Et tu le dis toi-même : « pas de mobile apparent ». Pourquoi tu nous fais traverser ça ? T’aurais pu l’éviter.
ALEXANDRE HOS
Non, je n’aurais pas pu. Mais j’ai triché avec la réalité. C’est un roman à clés, tu le sais.
Dans une histoire où la violence est systémique, insidieuse, où la justice elle-même est biaisée — parfois complice — il fallait que cette scène existe.
La tentative de meurtre sur Caroline Darme, ce n’est pas un twist. C’est un point de rupture émotionnel.
Le moment où même les lecteurs doivent se demander s’ils ont encore envie de lire cette histoire.
S’ils sont prêts à aller jusqu’au bout.
C’est aussi un miroir tendu aux institutions. Parce que ce genre de crime, dans la réalité, arrive souvent dans le flou.
Trop vite classé. Trop vite digéré.
TOM ROUSSEL : Tu parles de la réalité. Mais on est bien dans un roman, non ? Pourquoi tu insistes autant sur ce que tu appelles la « matière du réel » ? Tu pourrais tout inventer. Pourquoi rester dans le flou de ce qui pourrait être arrivé ?
ALEXANDRE HOS
Parce que je crois que la fiction est plus forte quand elle ne cherche pas à rassurer. Quand elle ne donne pas de leçon, ni de confort. Je ne veux pas qu’on referme Mélodie en haine mineure avec l’impression que les choses sont rentrées dans l’ordre. Ce serait une insulte au sujet.
Ce que raconte le narrateur, c’est la mécanique d’une société qui se délite, d’un système judiciaire qui fabrique ses monstres, d’une vérité qui n’arrive jamais tout à fait à la lumière. Caroline Darme est une victime collatérale d’un engrenage qu’elle ne comprend même pas mais dans lequel elle est complètement intégrée. Et c’est précisément pour ça qu’elle devait être là et de cette manière.
TOM ROUSSEL :Tu t’attaques à des sujets durs. Tu joues avec des silences lourds. Tu provoques de l’inconfort. Est-ce que tu veux qu’on t’en veuille un peu ?
ALEXANDRE HOS
Peut-être. Mais surtout, je veux qu’on se souvienne. Que quelque chose reste. Un frisson. Une gêne. Une impression de malaise qui ne s’explique pas tout à fait.
Car si l’écriture a une finalité, ce n’est pas de résoudre les choses. C’est de les laisser en suspens. D’ouvrir un peu plus les failles. D’ouvrir des portes aussi.
À suivre…
Prochain article :
Mourcoing, ville grise, ville vraie – une cartographie émotionnelle et sociale du décor
Abonnez-vous à la newsletter pour recevoir chaque article :
https://alexlienard.substack.com